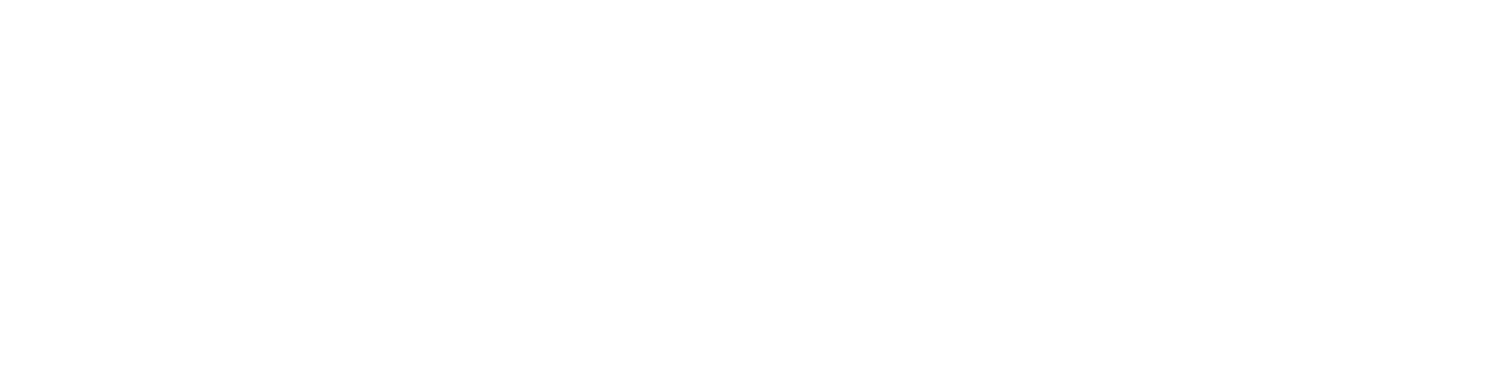Point et réinterprétation
02/02/2020
Écrit par Raphaël Sandoz
L'article aborde diverses approches théoriques qui développent les concepts de punctum et « sans forme » en relation avec l'image photographique.
Leur lien avec le concept de "tournant visuel" dans l'esthétique et la théorie de l'art est exploré. Avec des exemples de pratiques artistiques et photographiques modernes, il démontre un changement d'idées sur les limites de la représentation et les façons de réinterpréter la photographie moderne.
Le contenu de la photographie échappe facilement à l'interprétation. Mais peut-être cela indique-t-il qu'au moyen de l'image photographique, il était possible de capturer quelque chose qui ne pouvait être réduit à une interprétation allégorique ou symbolique. J. Baudrillard considérait l'imposition d'une interprétation excessive des photographies comme la cause de l'émergence des simulacres et, à cet égard, il distinguait l'image photographique réelle et la visibilité photographique. La photographie en tant que simulacre est privée d'originalité, d'unicité, est interprétée conformément aux clichés sémantiques et visuels (faut regarder cette phrase, pas sûr de ce qu'elle veut dire - devrait-il s'agir de 2 phrases distinctes ?). La visibilité remplace l'image (ou l'image) lorsqu'elle tente de se faire passer pour ou d'imiter la réalité, d'imiter la réalité. Contrairement à la visibilité illusoire, « une bonne photographie ne représente rien » [2, p. 224]. Mais qu'est-ce que « l'état pur de l'image » au sens de Baudrillard ? Premièrement, cet état implique une connexion directe, plutôt que médiatisée de manière conventionnelle, de l'image avec un lieu et un moment spécifiques.
La prise de vue, qui se retrouve également dans la notion de punctum de R. Barthes [1], Baudrillard y fait référence dans ses études, ou peut être rapprochée de la notion d'indice, que R. Krauss utilise dans l'analyse de la photographie [6] ( Je ne vois pas ce que vous dites dans cette phrase - qu'est-ce que tirer ? il ne semble pas y avoir d'explication ou d'achèvement de la phrase, à la place il y a des références sans conclusions ni déclarations). La « ponctualité » d'une photographie l'amène au-delà des limites de la représentation et en fait une fixation sur un événement unique. Pour Barthes, le concept de punctum implique un certain écart dans la composition figurative, une violation de la logique habituelle du rapport entre la partie et le tout : « … restant un détail, il remplit paradoxalement de lui-même toute la photographie » [ 1, p. 62].
Punctum ne peut être localisé, associé à aucun dispositif pictural spécifique ou (?) présenté comme un « jeu intellectuel ». Bart juxtapose punctum au "champ aveugle de l'image", "l'espace de l'envers du décor", implique la présence dans l'image d'une dynamique interne, éclatant au-delà des limites de l'image. Selon Barthes, le punctum est révélé dans la photographie post factum, contre la volonté de l'auteur. Mais n'est-il pas possible de supposer que l'auteur parvient à obtenir l'effet de non-codage même lorsqu'il cherche spécifiquement un moyen de libérer le paradoxe et la spécificité internes de la photo-image ? Est-il possible d'élargir le concept de punctum et de le comparer à des caractéristiques d'image telles que l'incertitude, la diffusion ou (?) la dualité ? Caractéristiques qui sont des conséquences involontaires du travail délibéré du photographe. En d'autres termes, est-il possible de comparer la variété des modes picturaux, dont l'auteur ne prédétermine délibérément pas l'interprétation, avec le concept de punctum ? Peuvent-ils être construits selon des approches à la fois figuratives et non figuratives ?
est historienne de l'art et conservatrice spécialisée dans l'art et la politique français du XXe siècle. Ses recherches portent notamment sur la diplomatie culturelle, les migrations et les échanges culturels entre la France et les États-Unis. Il est professeur adjoint d'histoire de l'art à Cooper Union, où il coordonne le programme d'histoire et théorie de l'art. Il est titulaire d'un doctorat du Département d'histoire de l'art du Graduate Center CUNY, ainsi que d'une maîtrise et d'une licence en histoire de l'art de l'Université Côte d'Azur à Nice. Sandoz est l'auteur de deux monographies en français, Leroux Cape : Performances et Puissance (Paris : Editions Cercle d'art, 2007) et Etienne Romaine : Peinture, Exil, Amérique (Paris : Éditions Karthala, 2018 ; édition anglaise à venir), et de nombreux articles pour des revues académiques (International Yearbook of Futurism Studies, Oxford Art Journal, Tate Modern's In Focus) et catalogues d'expositions (CIMA, New York ; Musée d'Art Moderne Et d'Art Contemporain, Nice ; Frederick Kiesler Foundation, Vienne). Son principal livre sur le sujet, The Science of Culture and the Phenomenology of Styles, a été publié en anglais en 2012. Conservateur ainsi qu'auteur de nombreux essais et livres, Sandoz est particulièrement connu pour son intérêt pour le postmodernisme et le mouvement artistique.